Gravir une montagne pour y trouver un shitpost
Critique de Death Stranding (Kojima Productions, 2019)
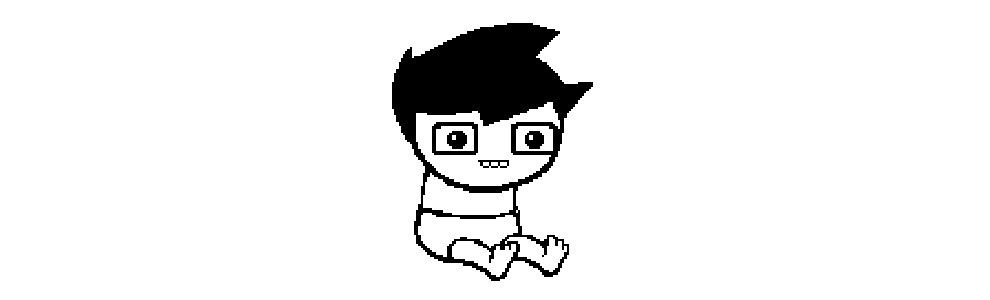
Il est probablement plus intéressant de réfléchir à Death Stranding que de jouer à Death Stranding. J’en veux pour preuve l’abondance d’analyses passionnées qu’a suscité le jeu, et qu’on ne peut pas attribuer exclusivement à la notoriété de son créateur ou de ses acteurs. Ainsi, pour ne pas risquer de répéter ce qui s’est sans doute mieux dit ailleurs, et aussi pour que cette critique ne mute pas en un article pour Argine qui prendrait des semaines à rédiger, je vais faire l’inverse de tout le monde et nier la complexité de Death Stranding pour en parler comme d’un petit jeu indé sans prétention.
Donc, Death Stranding est un jeu de science-fiction où il faut rallier des endroits éloignés sur une grande carte sans se rompre le cou, mais surtout sans abîmer les kilos de marchandise qu’on doit transporter sur son dos. Au début, c’est pas facile, et c’est exaltant. Après avoir traversé l’enfer et livré vos précieuses caisses, les destinataires vous remercient en vous donnant de quoi fabriquer des véhicules et des ponts qui vous faciliteront grandement les livraisons suivantes ; vous pourrez même profiter de ceux posés par d’autres joueurs en ligne. Le jeu essaie de limiter leurs apparitions histoire de ne pas s’autodétruire ; mais pourtant, en tout cas en difficulté “Normal” (toujours jouer en difficile, je le sais pourtant !), c’est ce qui finit par arriver, transformant la randonnée coriace et mélancolique en un délire addictif de camtars bondissants et de tyroliennes de l’espace, qu’on parcourt sans effort sous les applaudissements de notre bébé (ne me lancez pas sur le bébé).
Mais Death Stranding n’est pas un petit indé sans prétention : c’est l’œuvre d’Hideo Kojima, un type doté d’un budget conséquent, d’une culture remarquable et d’un humour dérangé qu’il n’hésite pas à étaler sur tous ses jeux, lesquels étaient, ces vingt dernières années, exclusivement des Metal Gear Solid. Death Stranding, en tout cas à mes yeux, ne pouvait donc pas être un simple concept expérimental autour de la fetch-quest : il fallait que ça soit son triomphe émancipatoire, sa vengeance sur la famille Snake, la preuve irréfutable de son génie, un sommet de jeu vidéo. Un sommet certes, mais sur lequel est planté un shitpost : Kojima (ou bien son scénariste Kenji Yano, mais je ne suis pas dupe) écrit toujours n’importe comment, gaspille ses cinématiques à millions de dollars – et notre temps – dans des tirades cryptiques débitées par des pantins coincés dans des couloirs gris, tandis que les vraies bonnes idées de cet univers sont racontées dans des e-mails, pour l’amour du ciel, écrits par des PNJ sous MDMA qui mettent des emojis partout. À l’image de ces moments où Death Stranding balance du post-rock triste pendant qu’on lève une cybermoto en Y, le ton du jeu glitche entre mélodrame apocalyptique et farce absurde. Tout ceci est fascinant, et je ne dis pas ça pour me moquer : derrière ses atours de parvenu, une vraie expérience de jeu vidéo hors du commun se trouve dans Death Stranding. Pour l’apprécier, il faut juste pardonner à Hideo Kojima les 50 heures qu’il faut y consacrer, au risque de se sentir trahi.