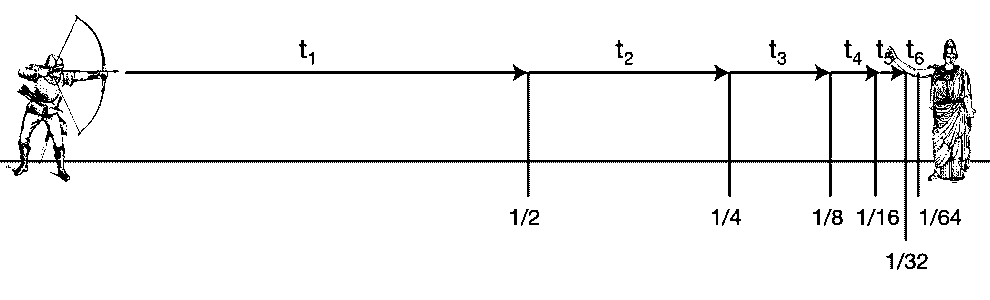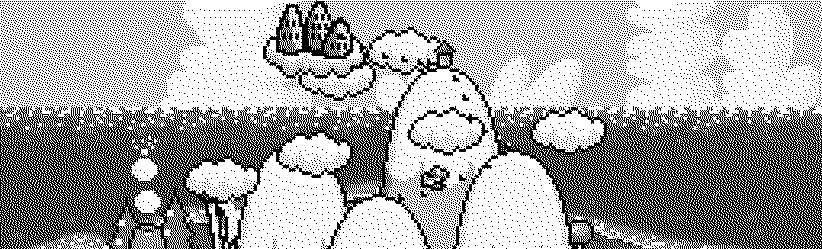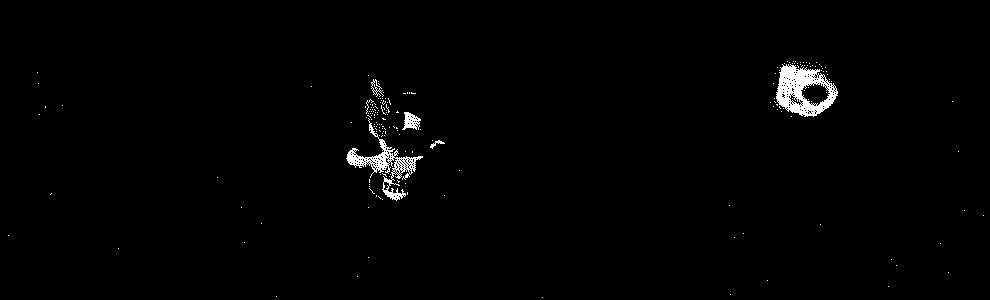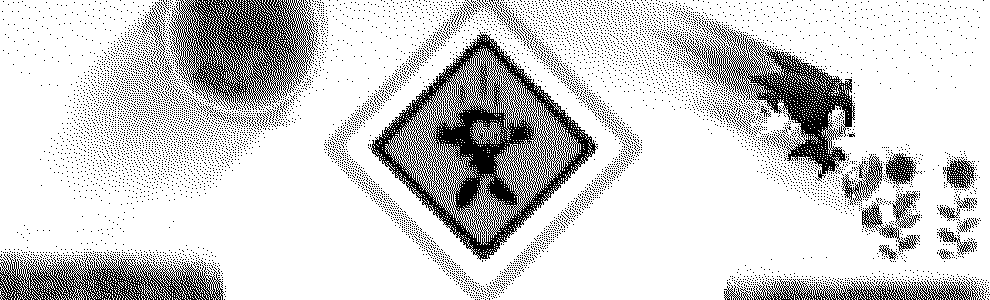Les heures les plus sombres de notre histoire
Critique de Animal Crossing: New Horizons (Nintendo EPD, 2020)
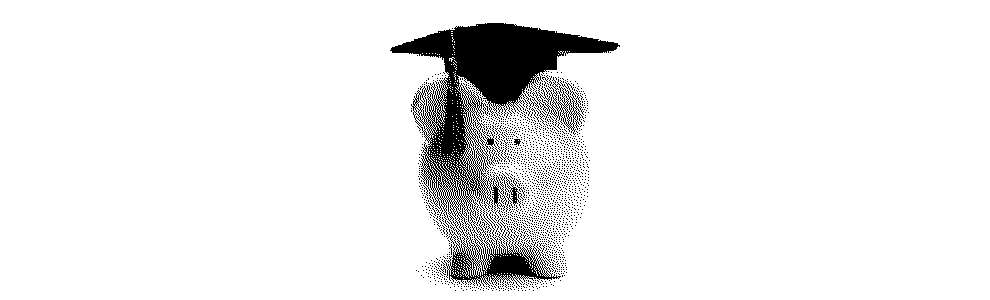
Il y a une certaine manière de jouer au dernier Animal Crossing qui me déprime un peu, car j’ai l’impression que c’est la manière dont ses créateurs veulent que l’on joue. Vous pouvez faire ce que vous voulez sur votre île, nous dit-on, mais si vous vous mettez aux ordres de the man Tom Nook ou des notifications de votre smartphone, vous gagnerez des points (des “miles”, qui comme dans la vraie vie, sont intelligemment distingués de la monnaie d’échange régulière). Coupez trois arbres, gagnez 200 miles. Pêchez trois poissons, 400 miles. Capturez cinq papillons, gagnez le double de miles – seulement aujourd’hui ! Le premier Animal Crossing, en 2001, avait le pari audacieux pour l’époque d’être un “non-jeu”, sans “challenge”, où on pouvait se contenter de “vivre sa vie”. Vingt ans plus tard, la vie est désormais gamifiée, et on peut faire tout ce qu’on veut sur cette île, sauf éteindre son smartphone.
Il y a toujours eu une certaine manière de jouer à Animal Crossing, avec ou sans smartphone : en pillant chaque jour les ressources qui y repopent. C’est comme ça qu’on y gagne de l’argent, du vrai, qu’on peut ensuite dépenser dans des meubles à mettre dans sa maison, ou bien dans l’agrandissement de celle-ci. Par une pirouette psychologique qui a suscité des dizaines d'“analyses” de la série (probablement autant que pour les Souls), Tom Nook vous livre d’abord l’agrandissement avant de vous laisser le rembourser, sans échéance, puis de vous en proposer un nouveau. Ce n’est donc pas la dette exorbitante qui vous empêchera de remplir votre maison de poupée de meubles de poupée (tel un « ensemble vaisselle » ou une « pile de documents » avec un petit camembert Excel dessus) lesquels, par nature, ne servent à rien, excepté la NES qui à l’époque, sur GameCube, permettait de lancer de véritables jeux ; aujourd’hui, la totalité de ces jeux est offerte avec un abonnement au jeu en ligne de la Switch, obligatoire pour pouvoir visiter les îles des autres joueurs de New Horizons, et constater qu’ils possèdent plus ou moins (dans mon cas, c’était toujours beaucoup plus) de meubles inutiles que vous.
Il y a une certaine manière de jouer à Animal Crossing, dès lors qu’on accepte que l’accumulation de richesses n’a pas d’autre but que l’accumulation de richesses, et elle consiste à n’en avoir rien à foutre. Comme le font les villageois, le véritable cœur d’Animal Crossing, qui parlent de « partir chercher à manger » ou de « fonder un club de lecture » alors qu’il n’y a ni épicerie ni livre, qui errent sans but entre des poteaux électriques débranchés et des piscines où personne ne se baigne, qui ne disent rien d’intéressant entre deux fulgurances poétiques, et qui, un jour, sans qu’on sache très bien pourquoi, se mettent à vous donner des surnoms affectueux et à vous envoyer des cartes postales où ils se plaignent d’être accusés de tapage nocturne par des voisins qui n’existent pas. Quand à la fin de celles-ci, dans une des dizaines de tournures de phrases concoctées par les auteurs et les traducteurs du jeu, le petit animal virtuel nous demande de lui répondre, on peut ressentir ce pincement au cœur qui fait décoller Animal Crossing bien au-dessus de son capitalisme de carnaval, à l’heure où des milliards d’êtres humains enfermés chez eux ne peuvent plus cultiver leur jardin.