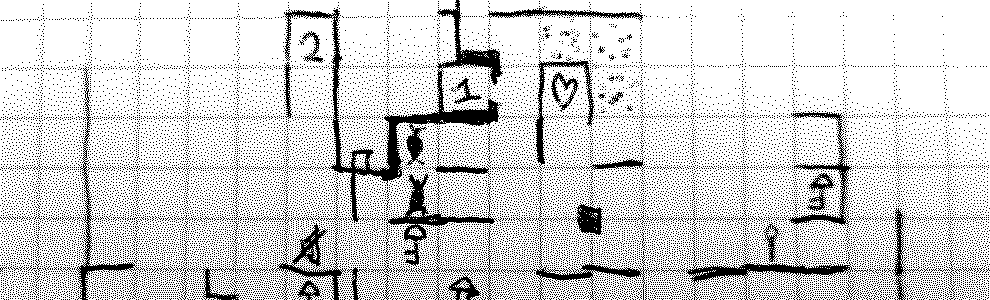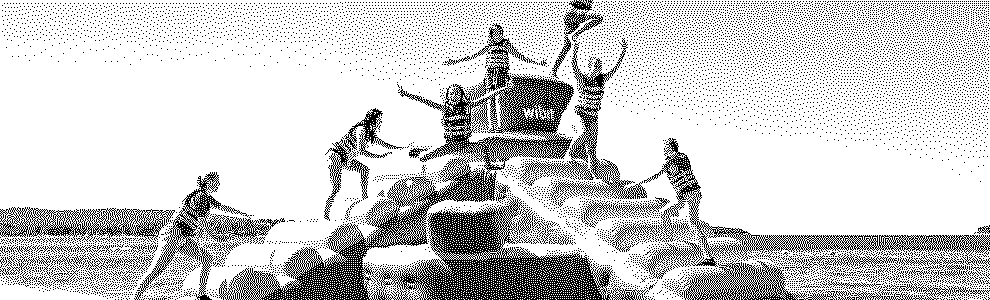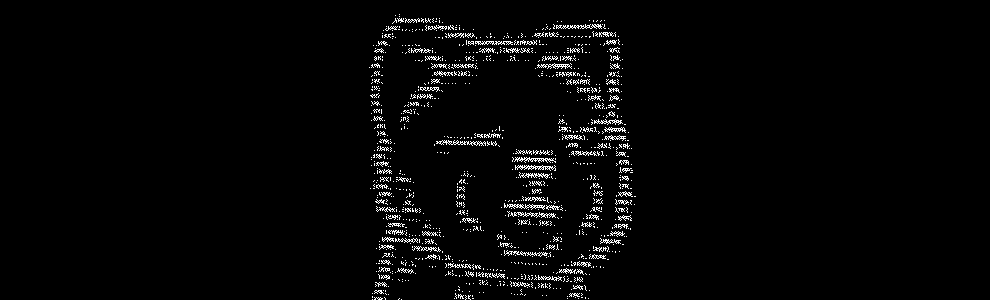Un cauchemar d’adultes
Critique de B3313 (ChrisRLillo, 2023)

Franchement, je n’ai pas du tout l’impression qu’il soit nécessaire que je vous parle de Super Mario 64. J’ai déjà dû le faire ici à deux-trois reprises sans même m’en rendre compte. Il doit y avoir tous les 6 mois des vidéos de deux heures qui sortent sur ce sujet, et des vachement bien en plus. Le jeu est sorti il y a vingt-huit ans et entre toutes les interviews, les vidéos exhumées des versions de travail, le gigaleak, le portage PC et toutes les rééditions, j’ai l’impression que Mario 64 ne nous a jamais quitté, qu’il n’a jamais été obsolète, alors que les autres pionniers de la 3D comme Tomb Raider et GTAIII n’intéressent plus que les vieilles badernes. Faut-il vraiment qu’à mon tour je vous narre la magie des premiers sauts en longueur dans la cour du château, la surprise de voir de la lumière éclairer le hall d’entrée après avoir eu la 10ᵉ étoile, ou de trouver la piscine de métal liquide, ou de faire partir le sous-marin, de voir Lakitu dans le miroir, de faire stopper l’horloge, de sauter en arrière dans l’escalier sans fin ? Vous savez tout ça par cœur, n’est-ce pas ; vous êtes convaincus, comme tout le monde, que Mario 64 est et sera pour toujours un des meilleurs jeux du monde, et qu’il est donc inutile que je vous le rappelle à nouveau ?
Ou alors, peut-être qu’en réalité vous ne savez pas tout ça. Peut-être que ce vieux machin de 1996 vous laisse tout à fait indifférent, peut-être que la vraie raison pour laquelle je n’ai pas besoin de parler de Mario 64 est que vous n’en avez pas envie. Peut-être suis-je moi aussi devenu une baderne, incapable de changer d’avis, cramponné à mes souvenirs d’un jeu tant encensé qu’on ne sait plus réellement ce qu’il vaut. Peut-être que la seule évocation de B3313, un mod de Super Mario 64 qui s’inspire de vidéos d'analog horror basées sur des creepypastas du fandom issues de cet iceberg de légendes urbaines elles-mêmes nées des premiers screenshots de la beta et les reportages confus que les journalistes en faisaient alors, est à-même de vous plonger dans un profond coma avant d’avoir fini de lire cette phrase. Et ce serait bien légitime. Comment expliquer alors que j’ai passé les derniers jours de mon chômage (celui que j’avais entamé en jouant 100 heures à Elden Ring lol) à jouer à B3313, comme jamais un jeu d'“horreur” ne m’avait donné envie de le faire de mémoire ? Alors que le bousin est sorti inachevé et qu’il est virtuellement impossible d’en faire le tour sans aller lire le satané wiki ?
J’ai essayé de le faire longuement ailleurs, alors pour résumer ici : B3313 est le Mario 64 de mes cauchemars, le « meilleur jeu du monde » devenu gâteux et corrompu, le produit d’une hallucination collective à laquelle j’ai presque honte de faire partie. Une expérience fascinante, qui en dit plus long que la majorité des éloges qu’on fait à Mario 64 depuis ces premières photos floues du jeu en développement. Un produit de niche, oui, mais aussi l’aboutissement improbable et miraculeux d’un des plus grands phénomènes culturels de l’histoire du jeu vidéo. Soit ça, soit c’est juste qu’après avoir fait celui-là, je vais plus trop avoir le temps d’en faire d’autres avant un bon moment.