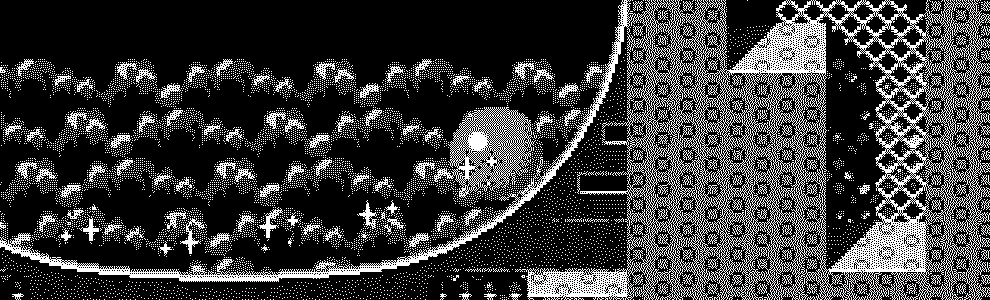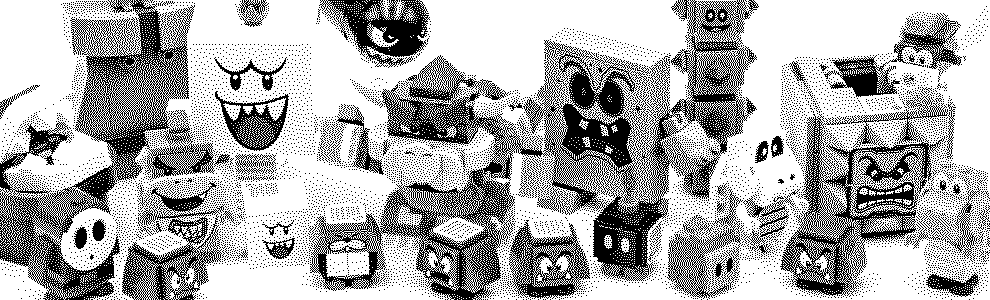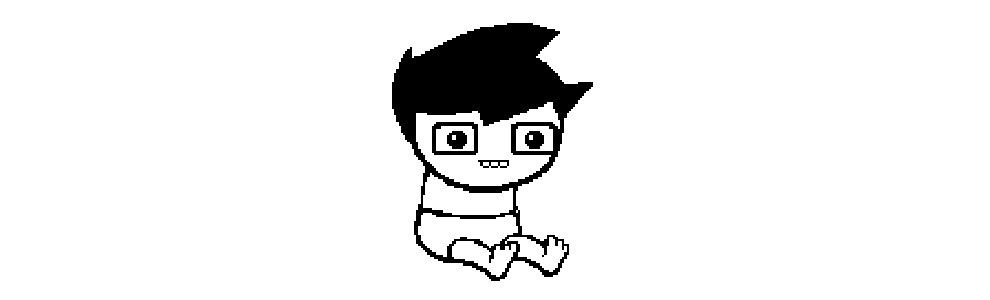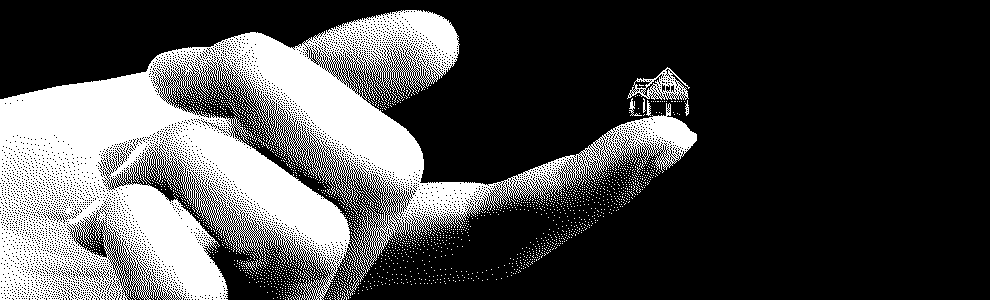Le plus bel ivrogne de la boîte
Critique de killer7 (Grasshopper Manufacture et Capcom Production Studio 4, 2005)

Plus encore que dans les autres jeux de Suda51 auxquels j’ai pu jouer (à savoir les deux premiers No More Heroes), quasiment toutes les mécaniques de killer7 sont ratées. Interagir avec les PNJ revient à les écouter dire n’importe quoi d’une voix de robot dans un silence de cathédrale, avant qu’ils ne finissent par donner un indice à une énigme dont la solution est soit déjà indiquée dans la carte du jeu, soit digne des pires point’n’click, du genre « regarder une photo en étant devant une porte pour qu’elle s’ouvre ». À un endroit, juste à la sortie d’une salle de sauvegarde, spawnent trois géants qui vous tuent en un coup. Pas d’autre moyen pour passer que de les cheeser, ce qui est à peu près aussi amusant que d’aller chercher des ciseaux pour ouvrir un emballage alimentaire parce que l’ouverture facile est incompréhensible. Tout comme le scénario d’ailleurs, un délire post-Grant Morrison ou plutôt post-Kojima, pas aidé par la traduction française et divorcé du reste du jeu jusqu’à l’absurde. Le système de personnages tient à peine debout : pourquoi y a-t-il tant de salles où changer de perso s’il suffit d’appuyer sur Start pour le faire n’importe où ? Même la caméra a le don de buguer après avoir fait un demi-tour, donc en général quand on cherche à fuir un ennemi, donc en général au pire moment possible. Ce jeu est pas fini, et il n’y a pas besoin d’aller vérifier sur Wikipédia pour s’en apercevoir.
Si les mécanismes sont ratés, que reste-t-il ? D’abord l’ambiance. Ça saute aux yeux : killer7 est stylé, cryptique, malsain, distrait, vénère, prétentieux, bref : complètement bourré, donc fascinant à décortiquer pour tout amateur de fiction dérangée, qui plus est dans le jeu vidéo où 17 ans après, ces audaces punk sont toujours trop rares. Mais killer7 est aussi intéressant à dépiauter pour un autre genre d’amateurs, de game design ceux-là, qui verront dans le jeu une tentative, quand bien même foireuse, de faire un Resident Evil ultra-minimaliste, où comme dans les vieux jeux de Shinji Mikami (également co-scénariste de killer7) la priorité est donnée au spectacle visuel et aux angles de caméra cinématographiques plutôt qu’à la liberté de mouvement. En guidant systématiquement le joueur vers chaque point d’interaction possible, le mouvement sur rails décrié à l’époque résout un vrai problème des jeux d’aventure classiques, celui de la chasse au pixel – et Suda51 a dix ans d’expérience dans ce format au moment de faire killer7. Lequel est sorti six mois après Resident Evil 4 (Capcom Production Studio 4, 2005), toujours réalisé par Mikami, et qui a codifié une grammaire du jeu de tir à la 3ᵉ personne encore en vigueur aujourd’hui. Ce serait bien de voir les bonnes idées de killer7 faire des émules elles aussi, plutôt que de rester oubliées dans cette curiosité de l’histoire du survival-horror.